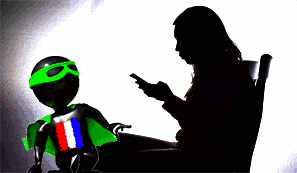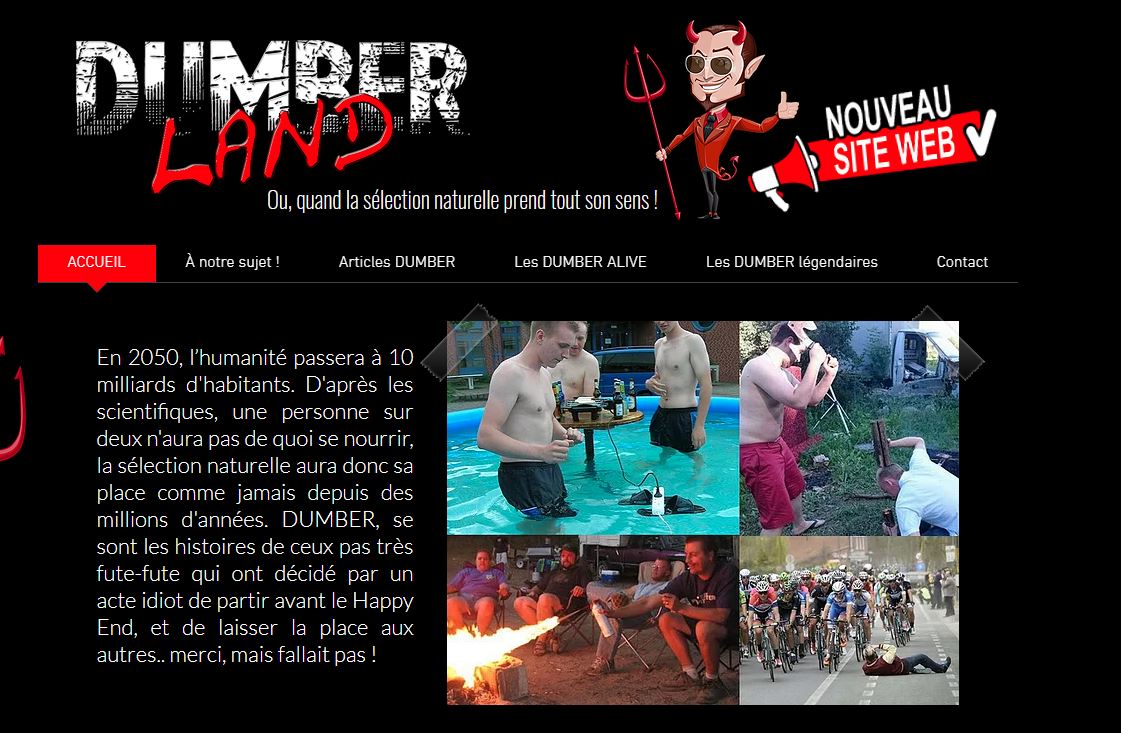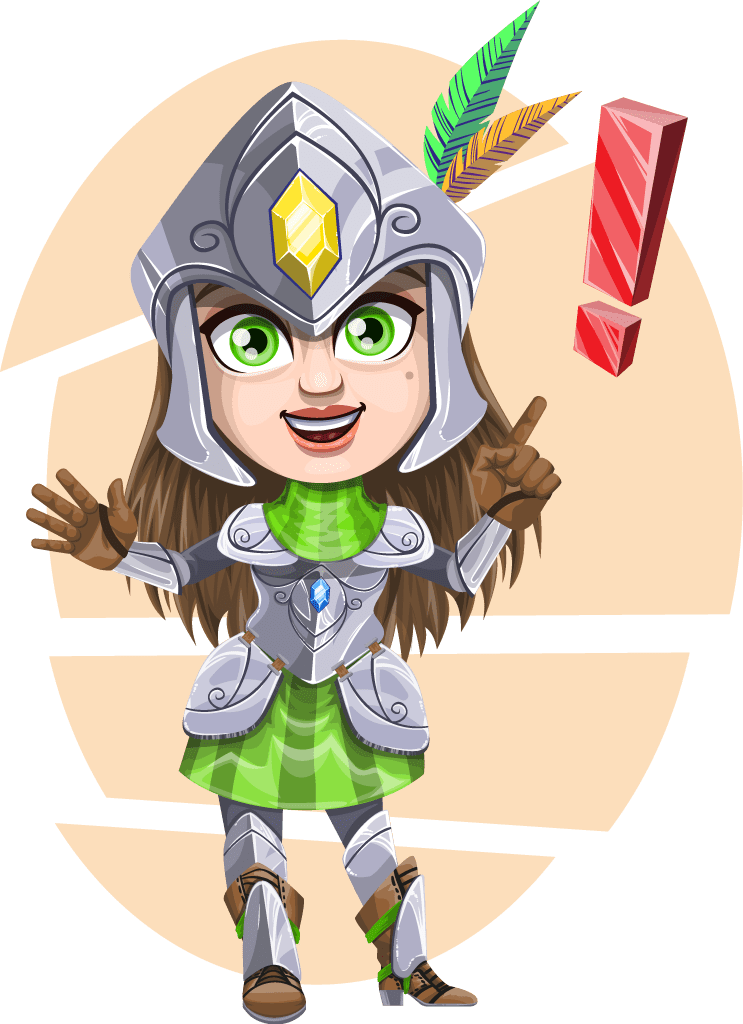Dans les rues embrumées du Paris du début du 17e siècle, le long de l’étroite Rue Saint-Jean-de-Latran où les marginaux de la ville trouvaient refuge, l’extraordinaire parcours de la famille Sanson vers la profession la plus crainte et méprisée de France ne commença pas par ambition, mais par un coup du destin qui allait à jamais bouleverser leur destinée. Les rues qu’ils arpentaient étaient les mêmes que celles où, des années plus tard, le romancier Victor Hugo puiserait l’inspiration pour ses récits sombres, écrivant dans “Le Dernier Jour d’un Condamné”: “Le bourreau ! Ce mot se tient seul… un mot terrifiant qui contient en lui tout un système de terreur.”
L’histoire commence en 1675, lorsque Charles Sanson, un jeune noble d’Abbeville en Picardie, se retrouva privé de son statut privilégié après l’implication de son père dans un scandale politique soutenant la rébellion de la Fronde contre le jeune roi Louis XIV. Avec la fortune de sa famille en ruine, Charles fut confronté à un choix impossible lorsqu’il tomba amoureux de Marguerite Jouenne, la fille du bourreau de Rouen. Leur cour se déroulait lors de rencontres secrètes près de l’abbaye de Saint-Ouen, où ils pouvaient éviter les regards vigilants de la société. À cette époque, épouser un membre de la famille d’un bourreau signifiait hériter automatiquement de la profession – un rôle qui, une fois accepté, marquait non seulement l’individu mais aussi les générations futures. Comme le nota le chroniqueur contemporain Jean-Baptiste de Saint-Victor : “Toucher le bourreau, c’était devenir le bourreau.”
La fonction de bourreau dans la France pré-révolutionnaire existait dans un étrange entre-deux social. Bien qu’elle offrait une sécurité financière grâce à un salaire régulier et des honoraires supplémentaires pour chaque exécution (variant de 5 livres pour une simple pendaison à 30 livres pour l’écartèlement), elle s’accompagnait d’un fardeau social presque insupportable. Les bourreaux n’avaient pas le droit de vivre à l’intérieur des murs de la ville – la première résidence parisienne de la famille Sanson était située près du tristement célèbre gibet de Montfaucon, où les corps en décomposition des criminels étaient exposés. Ils étaient tenus de porter des vêtements rouges ou jaunes distinctifs ou des marques identifiant leur profession, et il leur était interdit d’entrer dans les tavernes ou de toucher aux aliments sur les marchés. Un incident célèbre en 1696 raconte que l’épouse de Charles Sanson fut bombardée de légumes pourris lorsqu’elle tenta d’acheter du pain chez un boulanger local, ce qui conduisit à un décret royal protégeant spécifiquement les familles de bourreaux contre ce type de harcèlement.
Malgré ces conditions sévères, l’acceptation du rôle par Charles Sanson marqua le début de ce qui allait devenir la dynastie de bourreaux la plus célèbre de France. En 1688, il obtint le poste de bourreau de Paris, après la retraite de Nicolas Levasseur, dont la famille occupait la fonction depuis trois générations. Le poste parisien offrait des privilèges uniques : un salaire substantiel de 3 600 livres annuelles (équivalant à environ 150 000 dollars aujourd’hui), un logement gratuit près du Pilori des Halles, au 9 Rue des Cordeliers, et le droit de percevoir des honoraires supplémentaires pour diverses punitions administrées. Leur maison, qui subsista jusqu’aux rénovations parisiennes du 19e siècle, fut décrite par l’écrivain contemporain Restif de la Bretonne comme “un bâtiment sombre, aux murs hauts et aux rares fenêtres, ressemblant davantage à une prison qu’à une demeure.”
00:00 Comment la famille Sanson est devenue les bourreaux royaux de France
12:54 La science derrière la guillotine
29:03 Comment les Sanson ont mis fin à la monarchie française
39:40 La chute de la dynastie des bourreaux de France